Comment l’essor des sciences de l’ingénieur transforme-t-il la médecine ? Diagnostics plus précis, traitements personnalisés, intelligence artificielle au service des praticiens… ce dossier explore quelques avancées concrètes.
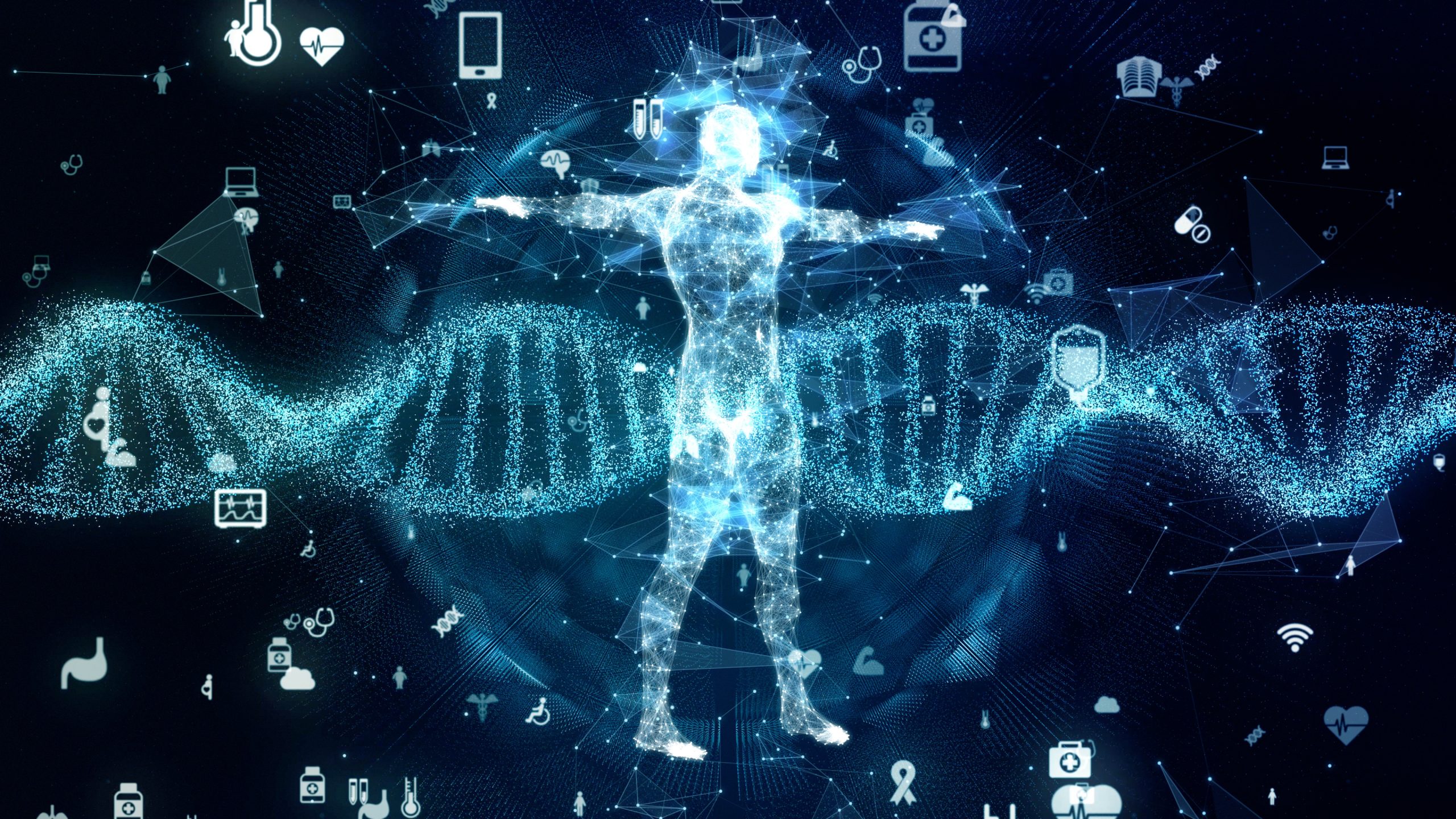
Au cours de l’Histoire, la médecine a connu une évolution lente dans ses ambitions : curative et réparatrice jusqu’à la Renaissance, tentant de devenir préventive à partir du XVIIIe siècle, elle ambitionne depuis trente ans de devenir prédictive, à l’échelle de l’individu. La médecine prédictive repose sur la capacité à prévoir à un horizon de 3 à 5 ans les complications d’une pathologie donnée et à identifier les patients les plus à risque de subir ces complications. Les sciences physiques, chimiques, électroniques et mathématiques lui en donnent à présent les moyens, en particulier grâce à l’apport de l’IA.
Le progrès de la médecine n’est pas linéaire, il a connu des régressions longues : les chirurgiens hellénistiques opéraient la cataracte et savaient trépaner un crâne, ceux de l’Empire romain cautérisaient les blessures au fer rouge, utilisaient le miel comme antiseptique, lavaient leurs instruments à l’eau chaude, maîtrisaient une chirurgie primaire de traumatologie. Ces pratiques furent oubliées au VIe siècle et redécouvertes… à la Renaissance !
À partir de la Renaissance, des progrès techniques de rupture ont accompagné ou rendu possibles des avancées fondamentales en sciences naturelles : développement de télescopes, de microscopes, de mesures du temps précises. Toutefois ces outils étaient encore trop rudimentaires pour permettre des progrès similaires dans le domaine du vivant, donc en médecine.
La révolution technique initiée au début du XXe siècle, conséquence directe de la révolution industrielle, ne cesse d’accélérer depuis lors ; on peut postuler qu’elle se structure autour de plusieurs axes majeurs :
- Techniques d’investigation et d’analyse (radiologie, IRM, scanner, microscopie électronique et confocale, imagerie cellulaire…)
- Ingénierie biologique et pharmaceutique (création de nouvelles molécules)
- Modalités thérapeutiques et chirurgicales (électrochirurgie et électro-chimiothérapie, optimisation des dosages, réalité augmentée, protocoles d’anesthésie)
- Optimisation des matériaux (émergence de composites, minimisation des risques de rejets, performances fonctionnelles des prothèses, etc.)
- Solutions réparatrices complexes (prothèses, stimulations sensorielles…)
- Traitement des données massives, prioritairement pour l’aide au diagnostic, mais aussi pour la prédiction de l’évolution des pathologies identifiées sur des populations “suivies”.
Naturellement la transition numérique permet des sauts quantitatifs importants dans le traitement des données massives comme dans les méthodes de télésurveillance et d’alerte en temps réel. Le domaine de l’Intelligence artificielle apparaît ainsi comme transverse à la totalité des disciplines citées plus haut, dans l’interprétation des données saisies (réduction des artefacts, tri et cohérence,) ainsi que dans l’entraînement d’algorithmes, notamment prédictifs (proportion d’une cohorte de patients qui développeront à terme de 3 ou 5 ans des complications graves de leur pathologie originelle, e.g.)
Toutefois, en aucun cas l’IA ne peut devenir une solution universelle, car “la médecine reste un art, non une science exacte” ; l’examen physique du patient par le praticien demeure indispensable, et l’expertise humaine autorise des choix thérapeutiques “hors normes” que ne suggérerait jamais un algorithme entraîné sur des données “classiques”.
De même, la qualité relationnelle entre patient et soignant ne relève pas des techniques d’ingénierie, mais bien d’interactions humaines irremplaçables (en particulier dans les pathologies lourdes et durables) qui impactent le moral du patient et donc sa volonté propre de “sortir de la maladie”
Par ailleurs la montée en puissance de l’IA comme outil d’aide à la décision des praticiens pose de sérieux problèmes de confidentialité des données, et de responsabilité civile (erreurs de diagnostic ou de manipulation, identification des effets secondaires nocifs d’un traitement, analyse “SWOT” sur les protocoles proposés aux patients, etc.).
Au plan économique et industriel, la multiplicité des champs d’intervention des techniques de l’ingénieur explique la profusion de startups et de jeunes entreprises servant le secteur médical, ainsi que le niveau des investissements financiers consentis tant par les pouvoirs publics que par les marchés privés. Un problème particulier, directement corrélé au financement des startups concerne le flou sur la propriété intellectuelle des inventions (généralement garante de leurs levées de fonds initiales) du fait de la multiplication des projets en partenariat, du recours aux logiciels “open source” (non protégeables) et de la montée en puissance de l’IA (zone grise de la jurisprudence actuelle). Les découvreurs peuvent même exercer des choix antiéconomiques, mais clairement altruistes, tel Jonas Salk refusant en 1955 de breveter son vaccin (par voie orale) contre la poliomyélite afin d’assurer une diffusion mondiale rapide et abordable.
La criticité des sciences de l’ingénieur dans tous les domaines de la médecine a légitimé aux yeux de notre Revue le choix du présent dossier ; l’appel à contributions lancé dès novembre 2024 a reçu une profusion de réponses riches et pertinentes, si bien que des arbitrages se sont imposés. Les nombreux contributeurs retenus illustrent chacun remarquablement une ou plusieurs des problématiques évoquées :
Martin Prodel(E10) nous raconte un exemple d’exploitation des données du Système National des Données de Santé (SNDS) pour une approche prédictive des pathologies graves concernant les diabétiques.
Guillaume Prunier (X04 et CM09) explique le cœur de métier de la startup Eukarÿs, inventeur d’un enzyme de synthèse d’ARN messager, multipliant par 5 à 7 la productivité des cultures cellulaires de biomédicaments.
Sacha Cavelier (E08) décrit les avancées prometteuses de matériaux multicouches de type céramique, aux caractéristiques mécaniques remarquables, dans le secteur des greffes osseuses.
Yann Bouteiller (ISMIN E16) travaille au Canada, au sein d’une équipe de chercheurs du laboratoire MIST : il nous détaille le système “Portiloop”, un boîtier d’électro-encéphalogramme doté d’une IA embarquée et permettant la détection de motifs cérébraux en temps réel (l’état de l’art étant l’analyse a posteriori). Entièrement développé en open source, ce système n’est volontairement pas breveté afin d’être accessible à tout chercheur en neurosciences.
Flora Ferrari (P16), Gautier Delprat et Vincent Pretet (P99) nous livrent une analyse stratégique fine des problèmes rencontrés par les startups du secteur Medtech (les dispositifs médicaux, par opposition aux molécules pharmaceutiques) de leur amorçage à leur maturité, et démontrent que leur sortie en capital aux USA plutôt qu’en UE est quasi inéluctable dans les conditions actuelles des marchés des capitaux.
Marie-Pauline Talabard (E10), ingénieure, mais aussi médecin, nous partage les récents progrès de sa spécialité, la radiologie interventionnelle : le recours au “jumeau numérique” pour simuler le déroulement de la procédure d’électrochimiothérapie et la réponse au traitement.
Vincent Augusto (E08) nous décrit un ambitieux programme d’ingénierie des territoires de santé, piloté par l’IMT et regroupant plusieurs écoles des Mines (Saint-Étienne, Alès, Albi) pour lutter contre la désertification médicale dans de nombreux départements et reconstruire des “réseaux territoriaux de soins”.
Alain Combescure (X70 et P73) présente le succès de la collaboration entre son équipe d’ingénieurs de l’INSA Lyon et des chirurgiens vasculaires, pour développer un outil de simulation de pose de stents aortiques (traitement des anévrismes) par voie endovasculaire.
Victoire Blandin (P12) a récemment rejoint Artha France, startup dédiée à l’assistance aux non-voyants : une ceinture haptique envoyant des impulsions tactiles en fonction des images transmises par une caméra permet au cerveau du porteur de percevoir des images virtuelles 3D de son environnement immédiat.
Le nombre des articles calés dans la version papier de La Revue demeure, pour des raisons techniques, limité en regard du foisonnement des contributions que nous souhaitions partager. Nous vous proposons donc trois articles en version en ligne seulement :
Raphaël Falco (MS E10 et DOCT. P15) et Clémentine Hatton (diplôme d’ingénieur et doctorat en neurosciences) décrivent leur technique de simulation de données d’imagerie médicale et son application en complément de données réelles pour mieux entraîner les algorithmes d’IA d’analyses d’images et dépasser les performances de l’analyse humaine – www.bit.ly/Mines527-RF
Carole Zisa-Garat (P99) a fondé en 2013 la plateforme Telegrafik dédiée à l’aide aux personnes âgées dépendantes (prioritairement en EHPAD). Elle nous en présente l’architecture et les modes opératoires ainsi que les facteurs clés de succès de son déploiement à grande échelle – www.bit.ly/Mines527-CZG
L’angle des jeunes promotions nous propose le témoignage de notre camarade Hanna Kleinman (P21) qui, suivant les traces de Marie-Pauline Talabard, a intégré Mines Paris Tech après 3 ans d’études de médecine et synthétise deux cultures dont la complémentarité est riche de promesses – www.bit.ly/Mines527-HK
Peut-être ce dossier suscitera-t-il parmi nos jeunes camarades encore en cycle d’études des vocations à mettre encore davantage les sciences de l’ingénieur au service de la santé de nos concitoyens ? C’est le vœu que nous formulons !





