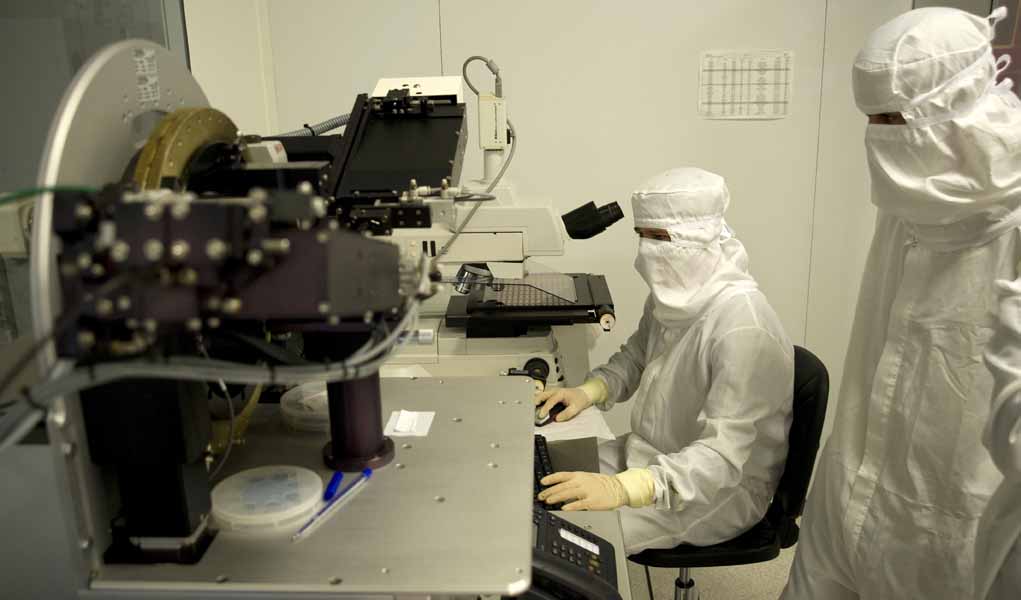Quelle place occupe actuellement la décarbonation dans les stratégies d’entreprise ?
Même dans un contexte tendu, aucune entreprise que je rencontre ne renonce à la décarbonation. Il y a cinq raisons majeures à cela. La première est liée aux exigences des donneurs d’ordre : les clients. Le patron d’une verrerie dans l’Orne m’expliquait que 70 % de son chiffre d’affaires dépendait des industries du luxe. Or, ses clients visent une décarbonation complète de leur scope 3 d’ici 2030. Il sait qu’il perdra ces marchés s’il n’évolue pas. La deuxième raison, ce sont les clauses environnementales dans le cadre des marchés publics. La troisième, c’est la finance. Même les banques traditionnelles flèchent désormais leurs investissements vers la transition écologique. Donc de plus en plus de dirigeants veulent devenir actifs de leur transition afin de rester éligibles à ces investissements. Une quatrième raison concerne l’appréciation des risques. Dans mes anciennes fonctions de DG d’entreprise, j’ai dû présenter des matrices de risques aux actionnaires. Aujourd’hui, le risque du coût de l’inaction est aussi lié au fait que personne ne sait combien coûtera une tonne de carbone dans cinq ans. Cette incertitude peut mettre à plat des modèles économiques, c’est donc un sujet d’entreprise vital. Enfin, et c’est notamment très présent pour les dirigeants d’ETI familiales, il y a une motivation intergénérationnelle : quel monde, quelle entreprise vais-je léguer à mes enfants et petits-enfants ?
N’y a-t-il pas un risque à court terme de surinvestissement dans la décarbonation au détriment des comptes de résultat des entreprises ?
La décarbonation d’entreprise ne génère pas de rentabilité immédiate, sauf sur un point : elle s’accompagne toujours d’un plan de sobriété énergétique. Vincent Adam, DG de Swiss Krono, l’illustrait parfaitement lors d’une conférence : “La décarbonation, c’est d’abord entre 10 et 15 % d’énergie en moins. Quand on refait toute l’ingénierie de la chaîne de production pour la décarboner, on travaille forcément sur la sobriété.” Ce retour sur investissement direct n’aurait pas existé sans le projet de décarbonation. Mais au-delà de ces économies, la décarbonation reste peu rentable à court terme. D’où l’importance de l’engagement de l’État et du rôle de l’ADEME comme opérateur public. Les entreprises doivent s’habituer à des rentabilités plus faibles, car la décarbonation va devenir une question de survie économique. Il y a aussi un avantage concurrentiel méconnu de la décarbonation grâce à l’électricité décarbonée française. Pellenc ST, PME devenue numéro 2 mondial des machines de tri optique laser, l’illustre parfaitement. Accompagnée par l’ADEME depuis 18 ans, l’entreprise n’avait jamais réalisé cet atout. Quand on lui a montré que ses machines électro-intensives, fabriquées en France avec une électricité 100 % décarbonée, avaient un avantage face à son concurrent allemand (25 % d’électricité au charbon), le dirigeant a réagi : “Cela fait 18 ans que je travaille avec vous, je n’avais jamais vu les choses comme ça.” Depuis, il intègre cet argument dans ses propositions commerciales auprès des collectivités sensibles aux enjeux climatiques. Un avantage évident, mais largement sous-exploité par les entreprises françaises.
Comment l’ADEME accompagne-t-elle les entreprises sur ces sujets ? Quels sont vos leviers d’action ?
Nous intervenons via trois leviers. Nous opérons le fonds France 2030 sur les sujets de transition écologique, notamment avec des plans massifs de décarbonation. Pour le compte de l’État, nous lançons l’appel à projets, nous évaluons les différents candidats et soumettons cette évaluation au gouvernement. Puis nous mettons en œuvre : contractualisations, négociations… Second levier, nous fournissons des outils méthodologiques pour évaluer la crédibilité des plans de décarbonation, comme ACT (Accelerate Climate Transition). Cet outil a connu une accélération fabuleuse en octobre dernier quand la Banque de France l’a choisi comme méthode de référence. Ça incite les autres banques, les fonds et donc les entreprises à s’aligner sur cette méthodologie. Troisième et dernier levier, l’accompagnement direct d’entreprises. Nous traitons les grands comptes et ETI directement, tandis que, pour le segment intermédiaire, c’est Bpifrance qui peut s’appuyer sur nos outils de diagnostic. En dessous, ce sont en général les CCI qui accompagnent à qui on fournit un outil “Mission Transition Écologique” qui aide les patrons de PME à se lancer, via quinze questions personnalisées en fonction de son secteur économique et des opportunités de son territoire.
Sur le premier levier, comment jugez-vous de votre performance dans l’utilisation des fonds France 2030 ?
Nos objectifs de performance vis-à-vis de l’État portent sur l’efficacité carbone de l’euro investi, les tonnes d’émission carbone évitées. Sur chaque dossier, pour chaque budget, c’est une exigence. Dans le cadre de nos contrats, il y a une vérification pluriannuelle de la tenue des objectifs, avec notamment des jalons à valider qui débloquent les fonds, graduellement.
Avec ce focus sur la tonne de carbone évitée, n’y a-t-il pas un risque d’investir dans des projets qui ne sont pas financièrement à l’équilibre ?
C’est justement parce que l’équilibre n’est pas là que l’État intervient. Qu’il s’agisse d’un réseau de chaleur ou d’une collectivité, ce n’est pas rentable sans l’aide de l’État. Les projets en entreprise sont cependant bien étudiés et jugés viables par les acteurs du privé qui participent aux investissements.
Sur les 3,4 milliards d’euros que l’État nous confie, 92% vont financer soit des projets de décarbonation d’entreprises (les deux tiers), soit des réseaux de chaleur et d’infrastructures.
Comment sont choisies les technologies dans lesquelles vous investissez ?
Nous avons élaboré avec les acteurs économiques des plans de transition sectoriels (PTS), pour comprendre les technologies nécessaires à la décarbonation des filières de l’acier, du carton, du verre… Ce sont des travaux qui ont suscité beaucoup d’intérêt de l’État, et nous présenterons bientôt cette démarche à Bruxelles. Ces PTS sont d’ailleurs disponibles à la consultation pour les différents acteurs qui se posent la question d’où va leur secteur. Vous y trouverez les enjeux, les technologies utilisées, quelles questions restent ouvertes et les trajectoires envisagées. Prenons l’exemple d’un besoin spécifique : les réseaux de chaleur. On a un ordre de mérite des énergies renouvelables qui s’appelle EnR’CHOIX : on commence par la récupération de la chaleur fatale, ensuite on part sur le solaire thermique, la géothermie, puis la biomasse non forestière et enfin la biomasse forestière. Les dossiers d’investissement doivent prouver que la récupération de chaleur fatale n’est pas possible avant de considérer les autres options.
Comment l’ADEME se positionne-t-elle face au débat sur la rationalisation des opérateurs publics ?
J’ai beaucoup pris la parole sur ce sujet, non pas pour polémiquer, mais pour apporter un éclairage rationnel à un débat qui était parti dans la polémique. Heureusement, cette question est désormais prise très au sérieux. Il y a effectivement un débat démocratique légitime à avoir : faut-il des opérateurs d’État ? Ces structures ont d’ailleurs été inventées par les libéraux anglo-saxons précisément pour avoir moins de fonctionnaires et plus de personnels de droit privé, avec des objectifs définis, des contrôles mesurables, des sanctions possibles et des audits réguliers. C’est exactement ce que nous sommes : 95 % de nos collaborateurs sont de droit privé, même si certains sont des fonctionnaires en détachement. Sur les 3,4 milliards d’euros que l’État nous confie, 92 % vont financer soit des projets de décarbonation d’entreprises (les deux tiers), soit des réseaux de chaleur et d’infrastructures. Là-dessus on peut se demander si l’État en fait trop en termes de transition écologique. Sur les 8 % restant, on peut se demander si l’opérateur est efficace dans la gestion des fonds qui lui sont confiés. J’ai été audité par l’Inspection générale des Finances, par 11 inspecteurs qui sont restés pendant 4 mois. Ils ont conclu que l’ADEME était “globalement bien gérée” et ont recommandé la hausse de nos effectifs. Voilà les éléments factuels que nous apportons au débat.
90 % des Français disent qu’ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des biens plus durables !
Certains critiquent l’accent mis sur les solutions technologiques et les gestes individuels, y voyant une façon d’éviter de questionner notre modèle de croissance et de consommation. Comment répondez-vous à cette critique ?
Nous sommes très actifs dans le questionnement de nos modèles. Vous avez vu la campagne “Posons-nous les bonnes questions avant d’acheter” (voir photo), dont le but était d’oser se questionner sur notre acte d’achat. Les bonnes âmes s’en sont offusquées, mais l’idée était bien d’interroger le modèle de société que nous souhaitons. Nous avons également travaillé sur quatre différents scénarios prospectifs à horizon 2050 1, fruit d’un travail interdisciplinaire mobilisant sociologues, économistes et ingénieurs. C’est un travail très riche qu’il est difficile de résumer, mais ces quatre chemins dessinent autant de voies possibles vers la décarbonation. Le premier mise sur la sobriété contrainte : l’État joue un rôle central via la réglementation et la fiscalité pour orienter les comportements, tout en maintenant la croissance. Cela questionne par exemple nos habitudes d’achat et de consommation. Le deuxième privilégie la coopération territoriale. On y trouve les Zones Industrielles Bas Carbone (ZIBaC), le développement de réseaux de chaleur mutualisés… Jusqu’à des exemples plus quotidiens comme ces groupes WhatsApp d’immeuble pour partager une perceuse plutôt que chacun achète la sienne. Le troisième, c’est la croissance verte : développement massif des énergies renouvelables, essor de l’industrie verte, nouvelles formes d’économie comme l’économie de la fonctionnalité où on vend l’usage plutôt que le produit. Le quatrième est plus techno-solutionniste, sans caricature : il mise notamment sur les technologies de captage du CO2 qu’on pourra déployer à différents degrés. Là, il faut suivre un chemin de crête : soutenir massivement l’innovation qui peut changer la donne, sans pour autant adopter une posture attentiste qui consisterait à dire qu’on n’a pas besoin de s’occuper du carbone maintenant, que la technologie émergera toute seule. Vous voyez bien que caricaturer l’ADEME comme adeptes de la décroissance, c’est faux : nous cherchons à nous projeter dans ces différents scénarios.
Votre campagne des “Posons-nous les bonnes questions avant d’acheter” remet-elle en question la notion de “pouvoir d’achat” ? Pourrait-on imaginer un indicateur plus qualitatif, intégrant par exemple la durabilité des objets achetés ?
Merci pour cette question très importante. La souveraineté va dans le sens du pouvoir d’achat, la durabilité va dans le sens du pouvoir d’achat, la réparabilité va dans le sens du pouvoir d’achat. Et cet argument n’est pas assez mis en avant, à mon sens. C’est le bon sens de nos grands-mères : “Ce qui est trop bon marché, c’est toujours trop cher”. Parce qu’on va acheter un t-shirt à deux euros, qu’on fait passer deux fois dans la machine et qu’on peut mettre à la poubelle ensuite. Ça n’est pas la même chose que d’acheter un t-shirt de qualité, recyclé en France, qui a duré cinq ans et en vivra encore cinq. Évidemment, ce dernier vous reviendra moins cher sur le long terme, même s’il coûte plus cher à l’achat. Le vrai pouvoir d’achat, c’est aussi cette capacité à investir dans des produits durables qui nous font économiser sur la durée. Nous visons l’anti-Shein. Il faut réussir à arrêter de faire circuler l’idée que les Français veulent absolument acheter moins cher possible, qu’on est champion du social quand on commercialise un t-shirt qui finira à la poubelle au bout de deux ports. On est à 3 milliards d’achats de pièces de textile en France par an. 3 milliards ! Soyons clairs, il y a un rapport à l’acte d’achat et aux limites planétaires, qui est en cours d’évolution, chez les consommateurs et dans les entreprises. Nous avons suivi pendant 18 mois huit grands groupes français qui repensaient leur offre en intégrant les limites planétaires. Les résultats sont frappants. Un vendeur de dérouleurs hospitaliers est passé de la vente d’équipement à la vente de service. Du coup, sa priorité devient la durabilité de l’équipement qu’il loue, plus le gain de marché à court terme.
Pour un fabricant de pesticides, le changement de paradigme a été saisissant : au lieu de vendre du pesticide, il vend des hectares de cultures en bonne santé. Grâce à l’IA, il peut déterminer en micro-localisation l’humidité, le vent de chaque parcelle et optimiser les quantités de pesticide. Le pesticide devient un coût et non plus un chiffre d’affaires, tandis que l’agriculteur a sa garantie de résultat. Repenser son offre en intégrant les limites planétaires et en inventant de nouveaux modèles économiques qui intègrent ces limites ne rime pas automatiquement avec décroissance. Tout le monde peut y gagner.
Caricaturer l’ADEME comme adeptes de la décroissance, c’est faux : nous cherchons à nous projeter dans les différents scénarios prospectifs à horizon 2050.
Ces transitions de modèles économiques semblent complexes et demanderont une certaine pédagogie. Le Slip français prônait les circuits courts et le made in France et doit aujourd’hui diviser ses prix par deux. Comment sensibiliser les entreprises à ces enjeux ?
Vous avez raison. J’étais récemment sur France Inter avec le patron d’Amazon France. Je lui ai fait remarquer qu’on peut trier les produits par prix sur leur plateforme, mais pas par impact environnemental ou durabilité. Amazon devrait proposer ce tri – cette entreprise en a la responsabilité. Aujourd’hui, on ne donne pas aux consommateurs les moyens de choisir en connaissance de cause. L’étape sui vante, c’est l’affichage environnemental systématique : quand vous ferez vos courses, vous aurez vos 83 euros de dépenses et vos 147 points climat. Vous pourrez faire votre bilan mensuel d’impact climatique et comprendre comment vos habitudes de consommation influent sur le climat. Prenez le thé : vous n’avez aucune idée de son impact climatique. La pédagogie a été faite sur le bœuf, les fraises en hiver… mais certains produits restent opaques. Informons nos concitoyens et faisons confiance à l’intelligence des Français. 90 % des Français 2 disent qu’ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des biens plus durables ! 90 %, ça comprend ceux qui ont des fins de mois difficiles. Tant qu’on ne donne pas les clés de décryptage, d’informations, on ne permet pas ce mouvement de se mettre en marche. Il faut évidemment une méthodologie transparente, avec des garde-fous validés par l’État. Ce qui reste opaque sera forcément suspect. Restons ouverts : une tomate produite sous le soleil d’Es pagne peut effectivement être moins impactante qu’une tomate française, malgré le transport. Ayons une discussion démocratique sur ces sujets. Il y aura des arbitrages à faire, et ils seront d’autant mieux acceptés qu’ils se feront dans la transparence.
Que conseillerez-vous pour à nos lecteurs pour être actifs dans la transition écologique ?
C’est bien sûr toujours une bonne idée de postuler à l’ADEME ! Nous n’avons jamais eu autant de candidatures depuis les polémiques récentes. Des jeunes quittent leurs CDI dans le privé pour venir prendre des CDD de 18 mois chez nous quand on lance un pro gramme. Mon message est simple : nos générations jouent un rôle déterminant. Évidemment, les ingénieurs ont des capacités particulières – ils savent lire les rapports du GIEC, décortiquer nos études… – et donc une responsabilité spécifique. Plus largement, les nouvelles générations jouent un rôle considérable dans la prise de conscience collective. On entend des chefs d’entreprise dire qu’ils sont obligés de décarboner, sinon les jeunes iront travailler chez la concurrence. Il faut absolument continuer à accentuer ce rôle. Malgré les contradictions propres à chacun – les jeunes sont aussi ceux qui achètent sur Shein et consomment le plus de numérique – cette pression générationnelle reste déterminante. Au passage, selon un rapport du Shift Project 3, le numérique a désormais le même poids que l’aérien. Il serait bien sûr absurde de s’opposer à l’IA, mais il serait irresponsable de ne pas se poser la question de la bonne mesure. J’intervenais récemment dans un master des Mines. Je leur passais ce même message : vous jouez un rôle déterminant, car votre statut d’ingénieur vous donne une crédibilité. Les Français ont du respect pour leurs ingénieurs, utilisez-le ! Parce que vous le pouvez, parce que vous avez les capacités, vous avez une responsabilité.
Sensibiliser à d’autres modèles
L’ADEME a lancé quatre spots publicitaires “Posons- nous les bonnes questions avant d’acheter”, mettant en scène des consommateurs sur le point d’acheter un polo, une ponceuse, un lave-linge et un téléphone. Au lieu de les pousser à l’achat, ces publicités les incitent à considérer des alternatives : location, réparation ou achat de seconde main. La campagne s’accompagne d’un site : epargnonsnosressources.gouv.fr. Un exemple: