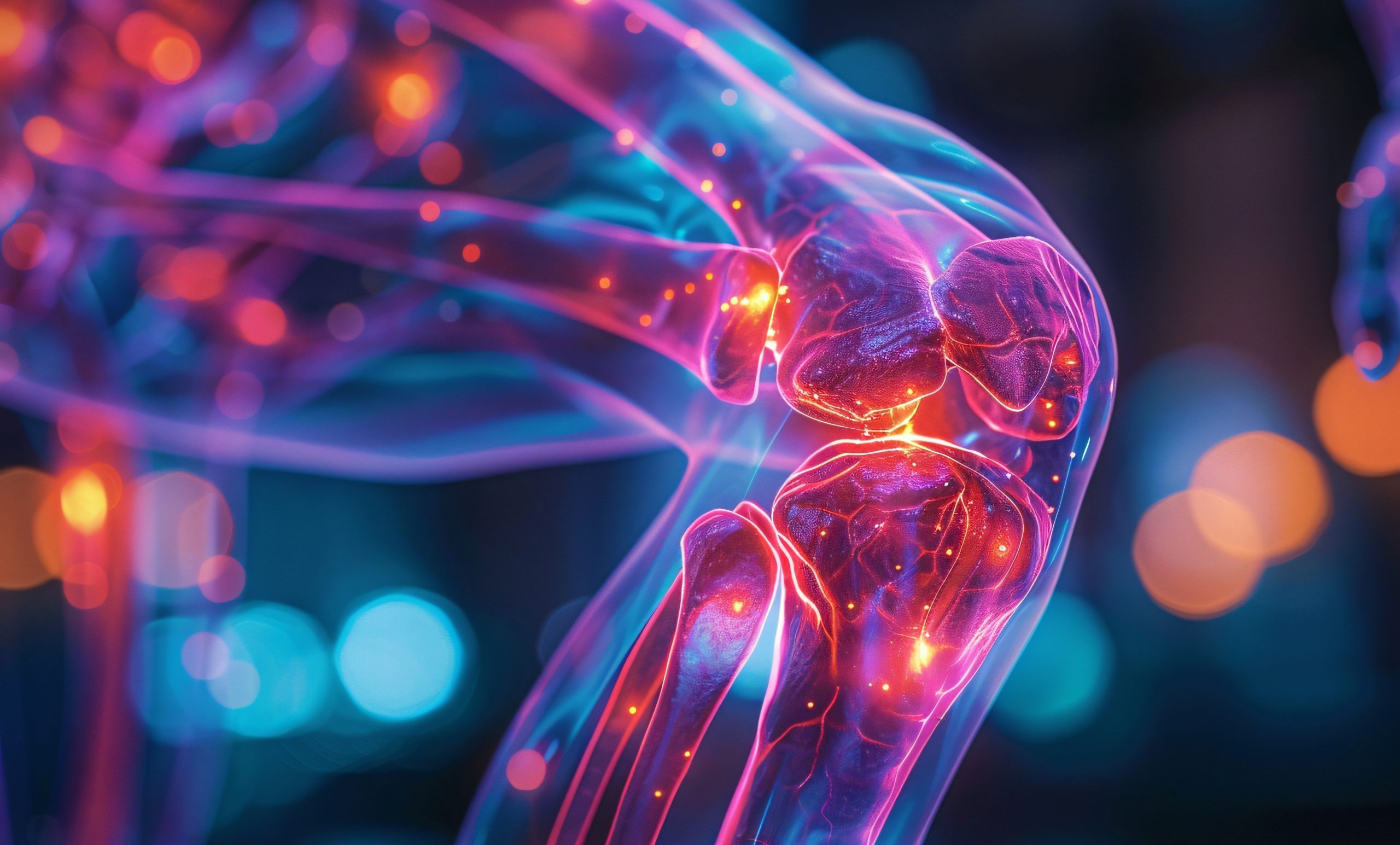Avec 10,8 milliards de dollars de financement reçus en 20241, la santé est le premier secteur bénéficiaire du financement en capital-risque en Europe. L’appétit des investisseurs pour les startups en santé est très important : (1) les innovations fleurissent continûment pour servir les exigences croissantes des patients, des médecins et des autorités de santé publique ; (2) les marchés sont larges et profonds avec une forte propension à payer pour la santé, du moins dans les pays occidentaux ; (3) le cadre réglementaire crée des barrières à l’entrée et (4) des industriels internationaux de la santé renouvellent leurs portefeuilles de produits de santé en procédant à des acquisitions ciblées de startups medtech performantes.
Les défis des startups en santé sont singuliers, tant dans la phase dite réglementaire, adossée à des études cliniques, que dans la phase commerciale. Nous vous proposons ici une revue des principaux enjeux des startups medtech, ces startups qui développent des dispositifs médicaux (DM) innovants, au service des médecins ou des patients. Nous n’aborderons pas les défis des startups biotech qui se concentrent sur de nouveaux médicaments.
Le trinôme entrepreneurial, facteur clé du succès
La plupart des startups medtech naissent de la rencontre entre un médecin, un ingénieur et un entrepreneur. Le médecin identifie un besoin : un outil ou une solution DM qui pourrait l’aider dans sa pratique clinique. L’ingénieur trouve une solution : il transforme l’intuition du médecin en un prototype puis en un produit, industrialisé et validé par les autorités de santé. L’entrepreneur teste et déploie le modèle d’affaires, il développe une société pour commercialiser le DM à grande échelle. L’importance de ce trinôme amène de nombreuses écoles d’ingénieur à proposer des parcours de spécialisation entrepreneuriale dans les medtech (Mines Paris, CentraleSupelec) voire des parcours d’ingénieur-médecin comme à Mines Saint-Étienne avec l’université Jean Monnet et le CHU de Saint-Étienne, ou à Mines Paris avec l’université Paris Cité.
Le rôle des fondateurs dans la trajectoire d’une startup est toujours prédominant : ils doivent s’impliquer à temps plein pour que le projet réussisse. S’il est rare de voir un médecin fondateur se consacrer à 100% à sa startup medtech, il est fréquent qu’il prétende à une détention très (voire trop !) élevée du capital social de sa startup. Il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre implication et détention du capital. La plupart du temps, les médecins restent à temps presque complet à l’hôpital ou dans leurs activités de recherche, où ils sont rémunérés. L’opportunité de quitter une carrière académique ou médicale de premier plan pour se lancer dans une startup leur semble souvent trop hasardeuse. Leur présence modérée au capital social, mais forte dans le comité scientifique de la startup est alors déterminante pour apporter les éclairages techniques requis, faciliter la phase de tests cliniques et accélérer l’adoption par leurs pairs.
Au-delà des équilibres de gouvernance, un autre enjeu est la différence de perception du temps. Le médecin s’inscrit usuellement dans une temporalité longue, celle de la recherche ou de l’hôpital, avec des financements et des processus bien établis. L’ingénieur et l’entrepreneur s’inscrivent dans la temporalité du marché, courte, avec des ressources limitées notamment sur le plan financier. La startup medtech doit s’assurer un “runway” suffisant et s’astreindre à un rythme de travail très élevé pour parcourir le chemin réglementaire et atteindre les jalons de performance qui activent les tranches de financement supplémentaires.
Les approbations réglementaires
Pendant les deux à trois premières années, les startups medtech se situent dans une “phase réglementaire” : elles vont chercher à obtenir des autorisations de mise sur le marché de leur DM : le fameux marquage CE dans l’Union européenne et l’approbation Food And Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Cette phase est adossée à deux stratégies : la stratégie clinique et la stratégie réglementaire.
- La stratégie clinique repose sur plusieurs études dont le protocole doit être conçu en vue de produire des données qui permettent d’étayer (1) l’innocuité et la robustesse du DM et (2) les bénéfices cliniques qu’il apporte.
- Les données issues de ces études constituent le socle technique nécessaire à la stratégie réglementaire : la documentation technique.
- La stratégie réglementaire peut s’appréhender par marché : la société vise-t-elle le marché européen et le marquage CE, ou le marché américain et l’approbation FDA ?
Le marquage CE dépend de la classe du DM. Une fois la classe identifiée, la startup entre en contact avec les Organismes Notifiés. Il s’agit d’organisations agréées par les États européens pour évaluer la conformité du DM et le système qualité du fabricant. Par exemple, une startup française peut faire certifier son dispositif par un Organisme Notifié italien, et le marquage CE sera valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Le choix de l’Organisme Notifié est crucial dans la stratégie réglementaire : les plus coûteux sont généralement les plus rapides. La durée moyenne d’un marquage CE est de 18 mois environ (dépendant de la classe du dispositif), les récentes années ayant plutôt penché vers un allongement de la durée du processus. Le marquage CE une fois obtenu implique des audits réguliers par l’Organisme Notifié, et peut être suspendu en cas de non-conformité. Le contexte réglementaire évolue : les sociétés ayant obtenu leur marquage CE avant 2017 font face aux modifications de 2017 et 2023 du règlement MDR2 et doivent se mettre en conformité avant 2028 pour continuer à bénéficier du marquage CE. Un marquage CE suspendu signifie l’interdiction de vendre !
Les délais d’instruction du marquage CE poussent certaines startups medtech en Europe à parfois lancer en parallèle, ou en premier lieu, le processus d’approbation FDA. Plusieurs types de soumission sont possibles auprès de l’agence fédérale :
- La soumission “de novo” est la plus ardue : elle vise à établir que le nouveau DM est conforme aux attendus de la FDA. Ce nouveau DM devient alors un “prédicat”, une référence en termes d’exigences.
- La soumission “510K”, ou “five-ten-k” dans le jargon, vise à établir que le DM de la startup est “substantiellement équivalent” à un prédicat : c’est une approbation par équivalence. Cette soumission est usuellement moins longue et moins onéreuse. Des cabinets de conseil spécialisés pourront identifier le prédicat pertinent pour soumettre la 510K. Une soumission 510K bien menée avec des données cliniques jugées satisfaisantes par la FDA peut aboutir en 6 mois.
Les investisseurs de pre-seed et de seed viennent financer cette phase réglementaire en prenant deux risques d’échec : (1) risque de données cliniques décevantes et (2) risque de non-obtention du marquage CE ou de non-approbation FDA.
La majorité des startups medtech en Europe cherchent à obtenir l’approbation FDA car la majorité des “exits” s’effectuent aux États-Unis (voir ci-après). Les approbations en Europe et aux USA constituent à la fois des barrières à l’entrée fortes, notamment lorsque le DM est disruptif sur le marché, et des marqueurs de valorisation. Après l’approbation, la valorisation de la société augmente fortement et la phase commerciale démarre.
Cette bascule se matérialise par une nouvelle étude : l’étude médico-économique qui a pour objectif de démontrer les bénéfices cliniques et les coûts associés au dispositif. Ces données vont servir d’argumentaire afin de convaincre les acheteurs du système de soin, ou les systèmes de santé dans l’optique d’un remboursement du DM. L’étude médico-économique constitue en réalité une partie du budget marketing de l’année suivant les approbations.
Les classes de Dispositifs Médicaux
- Classe I : dispositifs non invasifs
- Classe IIa : instruments de diagnostic, transport de fluides
- Classe IIb : dispositifs ayant un contact prolongé avec le patient : préservatifs, sutures non absorbables…
- Classe III : dispositifs implantables
DIFFICULTÉS LIÉES AUX DONNÉES CLINIQUES EN EU
Outre le choix entre un marquage CE, plus contraignant qu’une approbation FDA, les medtech sont confrontées à plusieurs difficultés liées aux données cliniques.
Durcissement législatif – La réglementation MDR en Europe a renforcé les exigences de génération de données cliniques pour les DM. Contrairement à la directive MDD, qui permettait d’invoquer l’équivalence avec des dispositifs similaires, la MDR impose de prouver des caractéristiques identiques (techniques, biologiques et cliniques). Si le dispositif de référence appartient à un tiers, un accès contractuel aux données est requis, ce qui est rarement viable. Pour les DM de classe III et implantables, des études cliniques spécifiques, souvent randomisées, sont presque toujours nécessaires, posant des défis méthodologiques.
Les biais des études cliniques – Les études cliniques sur les DM visent, comme pour les médicaments, à prouver leur sécurité et efficacité pour une indication donnée, en les comparant à un groupe de contrôle. Cependant, plusieurs biais compliquent cette évaluation. L’expérience de l’utilisateur est un premier biais : l’efficacité d’un DM s’améliore avec la pratique, faussant les comparaisons si les opérateurs sont peu expérimentés. Par exemple, en endoscopie, le taux de succès d’une procédure passe de 43 % à 80 % après 350 à 400 interventions3. Un autre biais concerne l’aveuglement des études. Contrairement aux médicaments, masquer le traitement est souvent impossible, ce qui expose les essais “en ouvert” à une surestimation de l’effet du DM. Enfin, l’usage d’un placebo pose un dilemme éthique : simuler une intervention peut impliquer des risques inutiles (anesthésie, incision). Des approches comme la pré-randomisation de Zelen visent à limiter ces biais tout en respectant l’éthique du consentement.
Le cas des maladies rares et des dispositifs pédiatriques – Dans ce cas, la MDR impacte fortement les dispositifs en raison des coûts élevés liés aux nouvelles exigences, provoquant des retraits ou des freins à leur mise sur le marché. Des alternatives, comme le Single Case Experimental Design, réduisent le nombre de patients nécessaires en utilisant un même patient comme son propre contrôle. En 2024, la Commission européenne a publié la guidance MDCG 2024-10, alignant l’approche sur celle de la FDA. Elle encourage la consultation d’experts et permet d’alléger certaines exigences cliniques si l’épidémiologie justifie des données limitées, sous réserve de preuves non cliniques solides et d’un suivi post-commercialisation. Par ailleurs, la MDR impose désormais une collecte continue de données après mise sur le marché, renforçant la surveillance des dispositifs.
L’expertise clinique externe – L’augmentation des exigences en données cliniques constitue un défi pour les startups medtech, rendant le recours à des expertises externes souvent indispensable. Les entreprises de recherche clinique sous contrat (CRO), biostatisticiens et experts en réglementation assurent la conception et l’analyse des essais, garantissant leur conformité. Cependant, ces services coûtent cher et peuvent freiner les startups sans financement adéquat. Ainsi, le financement des medtechs intègre de plus en plus ces prestations, et les investisseurs en capital-risque jouent un rôle clé pour concilier innovation, rigueur scientifique et viabilité économique.
Trajectoire commerciale et stratégie capitalistique : la sortie aux USA
Si la phase réglementaire constitue un investissement de 5 à 10 M€ pour les DM non-implantables, elle atteint 20 à 100 M€ pour les DM implantables. Après d’importants investissements initiaux, les startups medtech doivent relever un défi clé : définir leur modèle d’affaires. Contrairement aux autres startups, elles évoluent dans un marché encadré par le système de santé et ses réglementations.
Deux stratégies se dessinent alors : (1) viser le remboursement dans le système de santé publique français ou européen, fragmenté, au risque de ne voir jamais son DM remboursé si l’étude médico-économique n’est pas favorable malgré des bénéfices indéniables dans la prise en charge des patients ; (2) viser un développement commercial aux USA, dans un système de soins plus ouvert, entre système de santé publique et opérateurs privés de la santé.
Pour aborder cette phase cruciale, les fonds d’investissement spécialisés en santé recommandent presque systématiquement aux startups medtech de s’adjoindre les services d’un dirigeant (un CEO) expérimenté qui a déjà et développé les ventes d’une startup aux USA et mené une startup jusqu’à son acquisition par un industriel international (américain) de la santé (“un strategic player”). C’est donc souvent la seconde stratégie qui est retenue.
La trajectoire commerciale d’une startup medtech est considérée comme validée si elle dépasse deux jalons de chiffre d’affaires.
- Jalon n°1 : entre 2 et 3 M$ de revenus, la startup medtech4 prouve qu’elle trouve une place sur le marché et peut, si elle constitue un complément d’activité ou de revenus à un acquéreur stratégique, faire l’objet d’une acquisition à 30 M$ environ.
- Jalon n°2 : lorsque les revenus de la startup dépassent les 10 M$, avec un fort taux de croissance, la startup medtech5 peut faire l’objet d’une acquisition sur un niveau de valorisation beaucoup plus élevé, de 100 à 300 M$. Des transactions peuvent aussi intervenir sur des niveaux encore plus élevés, supérieurs au milliard de dollars, pour des solutions de niche à très forte valeur ajoutée.
Dans tous les cas, le rôle du CEO de la startup medtech est de simultanément développer les ventes et de marquer sa présence auprès des acquéreurs stratégiques potentiels.
Parfois, les acquisitions interviennent de manière progressive : (1) la startup medtech réalise de premières ventes et capte l’attention d’un potentiel acquéreur stratégique ; (2) un partenariat commercial est mis en place, la startup vend sa solution sous sa marque en bénéficiant du soutien opérationnel (son réseau de distribution principalement) du potentiel acquéreur stratégique ; (3) lorsque les ventes progressent, le potentiel acquéreur stratégique procède à un “deal de pré-acquisition”, il entre au capital pour un montant limité (quelques millions de dollars) et avec une détention limitée et commercialise la solution en partie sous sa marque ; (4) si les ventes sont performantes, l’acquéreur stratégique procède à l’acquisition complète de la startup medtech. Si tel n’est pas le cas, la startup medtech est en perdition, parce que trop proche d’un potentiel acquéreur stratégique, ce qui exclut a priori les autres offres d’acquisition.
Auprès des investisseurs du secteur medtech, ce “play book” ou manuel opératoire est bien établi : la startup naît et germe en Europe, elle se développe et se vend aux USA. Ce flux de startups medtech vers les USA crée un flux opposé de liquidité qui vient irriguer le secteur du capital-risque en Europe. En revanche, cela revient simultanément à confier aux opérateurs américains un contrôle de fait sur les nouvelles technologies de santé, qui sont en retour massivement vendues aux acteurs européens des systèmes de soins : hôpitaux, médecins, patients…
Les pouvoirs publics français conservent un droit de regard sur ces acquisitions lorsque les startups medtech restent des entités assujetties au droit français, via le bureau du contrôle des investissements étrangers en France (CIEF). Lorsque les entités relèvent du droit américain, il n’y a plus de contrôle effectif sur les acquisitions. Lutter contre cette tendance semble toutefois relativement illusoire puisque la plupart des acquéreurs stratégiques sont américains et que les options de sortie sont limitées en Europe pour les startups medtech, sauf à envisager un regain d’intérêt des marchés financiers pour assurer l’émergence d’acteurs européens indépendants dans la medtech, au travers de massives introductions en bourse ou d’apports significatifs de fonds de private-equity.